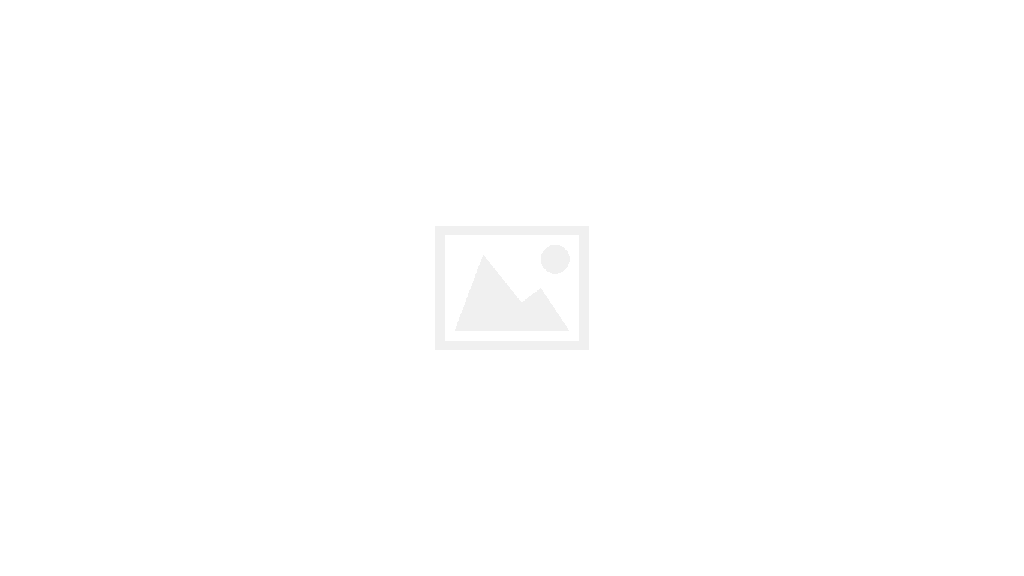Ce qui suit a été publié dans Magali Jeannin et Anne Schneider, Littérature de l’altérité, altérités de la littérature : moi, nous, les autres, le monde (Actes des 18e rencontres en didactique de la littérature, Caen, 2018), Namur, coll. « Dyptique », Presses Universitaires de de Namur, 2020, p. 23-34.
Identités, altérités : des relations de voix en littérature pour vivre langage et faire société
La Parole est moitié à celuy qui parle et moitié à celui qui écoute (Michel de Montaigne, Les Essais, III, 13, « De l’expérience »)
Il faudrait commencer par ce qui peut orienter décisivement toute la pensée des pratiques scolaires, y compris littéraires à quelque niveau qu’on s’arrête de la maternelle à l’université. L’orientation décisive consisterait à associer les pratiques langagières et les pratiques sociales et donc à ne jamais les dissocier comme on a malheureusement bien souvent l’habitude de le faire, soit en instrumentalisant les unes au service des autres, soit en les essentialisant et en les isolant les unes des autres. Associer ne veut pas dire penser le discontinu mais, au contraire, œuvrer au continu, et des pratiques et des théories. C’est pourquoi il s’agira de placer d’emblée toute la réflexion qui suit dans la lignée double d’un « vivre langage » et d’un « faire société », expressions fortes que l’on peut forger à partir des travaux d’Émile Benveniste (1966 et 1974) et de John Dewey (2010). Il semble depuis longtemps que cette double lignée engage une pensée de la relation où identités et altérités sont également engrenées et non séparées comme on le voit généralement aujourd’hui avec des politiques identitaristes qu’un altruisme de bon ton vient sauver in extremis sur la base d’un dualisme réitéré entre individu et société. En son temps, Benveniste (1966 : 260) avait dénoncé un tel dualisme après avoir posé que, « dans le langage », « la polarité des personnes » était « la condition fondamentale » où « je/tu » sont et « complémentaires » et « réversibles » – on peut prendre cette forte critique de Benveniste pour une réfutation forte des thèses traditionnelles de l’anthropologie philosophique toujours réitérée comme celle de Paul Ricœur (1990) :
Ainsi tombent les vieilles antinomies du « moi » et de l’« autre », de l’individu et de la société. Dualité qu’il est illégitime et erroné de réduire à un seul terme originel, que ce terme unique soit le « moi », qui devrait être installé dans sa propre conscience pour s’ouvrir alors à celle du « prochain », ou qu’il soit au contraire la société, qui préexisterait comme totalité à l’individu et d’où celui-ci ne se serait dégagé qu’à mesure qu’il acquérait la conscience de soi. C’est dans une réalité dialectique englobant les deux termes et les définissant par relation mutuelle qu’on découvre le fondement linguistique de la subjectivité. (Benveniste, 1966 : 260)
Mais, ici comme ailleurs et d’autant plus qu’on se situe dans le cadre des politiques scolaires, ce qu’on fait avec les œuvres littéraires mesure très rapidement ce qu’on fait avec les individus puisqu’on peut y tester immédiatement ce qu’on fait à la voix dans sa pluralité et dans ses résonances, parce que ce qu’on fait à la voix c’est ce qu’on fait au et du langage, si l’on part de l’hypothèse que plus il y a de voix plus il y a de langage et que plus il y a de langage et plus il y a de société, au sens d’une résonance des voix, d’une démocratie concrète et vive, et inversement. C’est sur ce point critique que j’aimerais donc situer ma réflexion dont on aperçoit qu’elle cherche à faire vivre une démocratie dès l’enseignement dans et par l’expérience continuée des œuvres, c’est-à-dire des relations de voix. Il n’y a ni début ni fin à un tel combat : il est à mener de la maternelle à l’université, et est de l’ordre d’une expérience engagée par chacun, élève ou/et professeur, tout contre les instrumentalismes politiques, idéologiques et culturels qu’ils soient institutionnels, partisans voire même généreux, souvent masqués par des attendus logiques qui ignorent toujours la force critique et plurielle, donc démocratique des expériences.
- Des dissociations critiques à opérer
Le dialogue est fortement évoqué dès qu’on veut penser la relation dans et par le langage. C’est le point de vue anthropologique qui fait dire à Benveniste, dans son article sur la « communication animale et le langage humain » dans Diogène en 1952, que « le dialogue » est « la condition du langage humain » (1966 : 60). Il n’empêche que les habitudes logiques l’opposent au monologue – comme on oppose logiquement identité et altérité, lequel pour le même Benveniste « doit être posé, malgré l’apparence, comme une variété du dialogue, structure fondamentale » (1974 : 85). Ces habitudesfont souvent oublier de penser pourquoi et comment je et tu doivent s’inventer dans une relation de sujet à sujet afin d’éviter les identités bloquées, essentialisées, désindividuantes et désubjectivantes, c’est-à-dire en donnant toujours voix à un je-tu puisque la seconde personne est potentiellement un je. C’est qu’en effet, le socle dialogique est décisif à toute relation, dialogale ou pas, puisque, selon la formulation décisive de Montaigne, « Chaque homme porte la forme entière, de l’humaine condition » (Montaigne, III, 2). C’est dans cette perspective anthropologique qu’on peut évoquer les deux points de vue toujours à l’œuvre, à partir de la très belle étude de Benveniste sur « les deux modèles linguistiques de la cité » : le point de vue réaliste, d’une part, pour lequel l’humanité (la culture, etc.) est constituée d’individus qui seraient chacun un fragment et, d’autre part, le point de vue nominaliste pour lequel les individus, et chacun d’entre eux, constituent l’humanité (la culture, etc.). Le point de vue nominaliste devient décisif en regard d’une confusion fréquente entre l’universel (« l’en-commun » selon Achille Mbembe, 2016) comme impératif catégorique et l’universalisation d’un modèle, d’une culture… Dans cette perspective, c’est le singulier qui est universel et alors les arts du langage, non comme genres ou techniques, mais comme subjectivations maximales dans des processus de trans-subjectivation, constituent des modes d’historicisation radicale (nominaliste) des valeurs contre tous les essentialismes (réalistes), des possibilités de je-tu continués, de voix possibles.
S’agissant de trans-subjectivation, en études littéraires comme en didactique des littératures, il semble indispensable d’exercer constamment la critique dissociative (voir Martin, 2017, « Introduction »). Celle-ci devrait, pour le moins, s’ouvrir sur quatre fronts qui entretiennent quatre activités critiques concomitantes visant la pluralisation, la défamiliarisation, l’historicisation et la confrontation des expériences littéraires. Pluraliser l’objet littéraire permet d’éviter des cadres trop normatifs tout en soutenant une attention aux pratiques, gestes, expériences et « tactiques » (de Certeau, 1980) comme autant d’opérateurs littéraires dans et par les « différences » (Saussure, 1975 : 166) qui ouvrent à la notion de valeur étant donné que « toutes les valeurs sont d’opposition et ne se définissent que par leur différence » (Benveniste, 1966 : 54). Défamiliariser (Chklovski, 2008) demande de dénationaliser, décentraliser, démarginaliser, déshomogénéiser toutes les catégorisations et autres typologies littéraires (au premier rang desquelles les genres) en les historicisant, en les situant et en en soulignant les tensions. Plutôt que de viser à des homogénéités, s’essayer à associer des hétérogènes et à opérer des montages dans la rédaction de « comptes rendus risqués » (Latour, 2006 : 177) qui racontent des parcours, construisent des histoires de lectures/écritures comme épopée de voix de lecteurs (Starobinski, 1968 et Martin, 2014). Enfin, la confrontation des expériences non pour les modéliser ou les homogénéiser mais pour les associer dans une démocratie des arts du langage, ouvre à un enchaînement concret et libre des expériences poétiques, politiques et éthiques.
Prenons un exemple en lisant cet extrait de Charles Pennequin dans La ville est un trou :
Ça veut dire quoi causer bien français. Je cause pas bien français moi. Moi monsieur mon père il cause la France. Et moi monsieur mon père il a causé et moi je cause. Et moi monsieur mon père l’a fait français dans la France moi monsieur. Moi monsieur qu’est-ce çà veut dire faudrait te causer français. Bien français. Mais moi monsieur suis français d’origine. C’est-à-dire je parle un français traduit dans l’origine. C’est l’original traduit en toutes les langues. Moi monsieur je parle toutes les langues dans seulement du français moi monsieur. Moi monsieur j’arrive à te parler dans toutes les langues dans du français correct. C’est-à-dire moi monsieur je reste correct quand je te parle alors moi monsieur je parle comme ça me pense. Et ça me pense en travers, parce que le travers des langues. Parce que mon père ma mère ma langue tout ça, toute l’origine trafiquée en travers, ça me reste moi monsieur. Moi ça me reste dans la gueule le français, alors moi veux bien faire l’effort, mais moi pas faire mieux que les efforts que moi faire pour bien parler. C’est-à-dire parler en travers. C’est-à-dire parler dans ma gorge avec tous les pères et les mères et des moi-monsieur dans le travers qui pousse. Le travers c’est moi monsieur j’ai traversé la parole pour savoir me taire. (Pennequin, 2007 : 113)
Cet extrait, que l’on peut lire à voix haute, phrase après phrase, dans toutes les bouches de l’assemblée (classe, séminaire), montre combien le régime de l’adresse (« moi monsieur ») pose un dire (« le travers ») avant un dit (« causer bien français ») et ouvre à une conception nouvelle du sens où le responsif sans question provient d’un phrasé qui est un pousse-à-dire. Alors, apparaît un parler de travers, un traverser qui se constitue comme une violence contre la violence (« ça me reste en travers »). On peut alors appeler voix-relation ce parler dans et par le traverser et ainsi concevoir la performance toujours en cours d’une voix-relation. Inutile ici de faire allusion à quelque situation de domination linguistique quand c’est l’évidence, avec un tel phrasé partageable, peut-être trop rapidement[1]. On peut alors comprendre l’enjeu didactique d’une liberté agrandie pour que des identités-altérités comme constellations rejouées ouvrent à des points de voix comme continu d’hétérogénéités conflictuelles. Ce qui entraîne la prise en considération de quelques notions critiques permettant de concevoir de tels points de voix et conséquemment une orientation didactique forte qui vise quatre déplacements décisifs :
- l’écoute de la force dans le langage par l’attention à l’énonciation plus qu’à l’énoncé ;
- la considération des passages de voix comme passages d’expérience par la préférence portée au racontage plus qu’au récit ;
- le pari de l’oralité où s’entendent davantage les rapports de voix que les postures énonciatives ;
- un engagement fort du côté des réénonciations comme activité continuée des œuvres à l’œuvre plutôt que la visée de leur explication/interprétation.
Ce qui implique un déplacement didactique où le levier de l’expérience littéraire n’est plus le sens ou la vérité mais la voix comme résonance générale, rythme, prosodie, c’est-à-dire rapports expérientiels de voix à voix, continu d’un dire en réénonciation inachevable.
Une telle orientation fondamentale avec les œuvres littéraires demande pour le moins d’abandonner les habituelles modélisations pour leur préférer les expériences plurielles et d’oublier les schémas délivreurs de vérités en laissant se dire des paroles porteuses d’expériences. Mais avant tout, la pensée didactique ne relève plus alors d’un projet de « communauté interprétative » (Citton, 2007). On ne sait pas assez combien un tel projet ouvre à des manipulations ou à des instrumentalisations parce qu’il reste foncièrement arrimé au modèle ancien et religieux de l’interprétation. Todorov réitère également un tel modèle interprétatif naturalisant un sens du « sens », qui rejoue le discontinu des « dimensions » en mimant la démarche phénoménologique, quand il conclut son essai « Art et morale » ainsi : « on peut convenir que la critique littéraire a un seul horizon qui lui soit propre : celui d’élucider le sens de l’œuvre, sens qui convoque simultanément ses dimensions cognitive, éthique et esthétique » (2015 : 131). Ce sont des peuples de langage dont il faut dorénavant apprendre à écouter les résonances plurielles voire conflictuelles mais toujours comme vives voix et donc comme histoires de voix en cours qui, de l’énonciation à la trans-énonciation, continuent les mouvements de la parole-relation dans l’écriture. Le continu d’un dire ainsi engagé demande de ne plus séparer textes et images, écrit et oral, culture et quotidien, etc., mais de penser le continu des expériences qui accompagnent la force des œuvres, leur effective mise en œuvre, les mouvements d’une parole dans toutes ses manières de dire y compris insues, invues voire inaudibles[2].
On continue avec la suite du texte de Charles Pennequin, La ville est un trou (POL, 2007, p. 114)
Et pourquoi se taire. Et pourquoi je me tairais. Et pourquoi je me tairais pas. Et pourquoi j’ai intérêt à me taire. Pendant qu’on parle. Pendant qu’on papote. Pourquoi je me tais pas quand je papote. Pourquoi je continue de pas papoter. Je devrais que papoter. Et pas que pas parler. Car me taire c’est aussi parler. C’est pas papoter me taire. C’est parler. C’est ce que je veux dire. Je sais pas ce que je dis. Je continue de pas papoter. Je me tais pas mais je me tais. Je sais pas ce qu’il faut faire. Je continue à pas faire ce qui faut faire. Je parle dans la parle. C’est-à-dire je me tais. Je me tais dans la parole. Voilà ce qu’il faut continuer de faire. Il faut continuer le taire en parole. Il faut le faire taire dans la parole. Voilà ce qu’il nous faut. Un bon faire taire. Un bon trou de taire qui vient dans tout le papoter. Le papotaire.
Cette trouvaille de langage que constitue le personnage rythmique, « le papotaire », vient comme parachever la critique de la notion philosophique bien installée, dans la comète heideggérienne française, de « bavardage » qui met le langage ordinaire dans une opposition insurmontable avec le « haut langage » (Auerbach, 2004). L’invention d’un taire dans le parler, ou du silence dans le langage, viendrait comme infirmer les habitudes qui ne cessent d’augmenter le hors langage. Du para-verbal à l’infra-verbal, ces catégories discontinuistes dénient ce qui est de tout le langage et donc du langage, peut-être même son cœur le plus actif : le silence est souvent ce qui parle le plus fort dans un texte loin de toute économie infra-verbale ; de même les gestes d’une parole font souvent le maximum de corps dans le langage loin de toute rhétorique para-verbale. S’aperçoit aussi, avec cette suite de Pennequin, le fait qu’une écriture inclut sa lecture et que toute lecture est portée par son écriture puisque faire entendre une voix c’est chercher à ce que cette dernière ne cesse de travailler : son inconnu comme force intempestive. Il y a de l’imprévisibilité dans l’activité des œuvres comme l’écoute d’une pluralité à l’œuvre qui ouvre à toutes les conflictualités permettant une politique de la voix où la vox populis’entendrait dans sa pluralité contre toute vox dei même laïcisée dans une vox populi réunifié par une rhétorique interprétative unitaire qui peut manœuvrer du slogan propagandiste aux charmes poétiques dans des instrumentalismes qui diminuent les vocalités et donc le dire de chacun.e.
L’enjeu didactique, tant du côté des apprentissages que des enseignements, devient donc celui de voir les voix. Aucun jeu de mot dans cette proposition autre qu’une référence à un moment biblique peut-être fondateur pour une pensée de la voix jusqu’en didactique : « et tout le peuple ils voient les voix » (Meschonnic, 2003 : 112 et 282) où non seulement le rapport entre voir et voix est fait mais aussi la pluralité du peuple est tenue.
- Essayer voir les voix de la classe au séminaire
Pour essayer voir les voix de la classe au séminaire, quatre lignes réflexives peuvent s’associer. La première revient à raconter sa lecture non pour la vérifier mais pour la construire à sa manière : anthologies, citations montées, parcours explicitées, échelles lexicales hiérarchisées… autant de manières de traverser une œuvre dans les conditions de ses lectures. La seconde cherche à vivre sa lecture non pour rendre un texte expressif ou exprimer ce que le texte retiendrait mais pour vivre au plus présent le présent du texte, sa voix : petits essais de scènes de voix et autres re/récitations pour que les gestes et les phrasés s’entendent et se voient par corps. La troisième vient aider à écrire sa lecture non pour évaluer des connaissances mais pour organiser les connaissances construites dans et par la lecture sous la forme de courts documentaires ou comptes rendus de parcours littéraire. Enfin la quatrième permet de poursuivre sa lecture en écriture continuée dans les voix qu’on masque pour entendre sa voix ou ses voix résonner dans les sans-voix (voir, pour quelques exemples précis, Martin, 2005 et 2018).
Avec le texte de Pennequin, dans une classe d’étudiants de 2e année de Lettres modernes, j’ai demandé d’abord de relever une liste hiérarchisée de mots faisant référence au langage ; ensuite le texte a été lu à voix haute deux groupes se faisant face, l’un en chœur et l’autre avec un lecteur par « phrase » ; à partir de ce texte, une tentative de documentaire illustré sur les défauts de langage est engagée en ne s’appuyant que sur le texte de Pennequin même si les dictionnaires-encyclopédies peuvent venir étayer les trouvailles et enfin, chacun se lance dans l’écriture des paroles intérieures du « monsieur » et/ou du « papotaire » (ces essais peuvent se contenter de bulles accolées au texte ou s’étendre jusqu’à poursuivre dans des séquences nouvelles le texte de Pennequin). À chaque activité s’ensuivent quelques échanges et confrontations qui permettent des retours sur texte, des reprises de voix et une véritable expérience réénonciative à la fois individuelle et collective.
Ces essais de voir les voix demandent à chacun.e de tenir au plus juste le continu du dire. Ce qui implique trois priorités didactiques : celle du dire, celle des arts du langage et celle de l’oralité. Je les reprends une par une mais elles œuvrent ensemble pour une pensée du continu des activités et des réflexivités. Penser une didactique du continu parler, lire, écrirepar le dire et donc par la voix (voir Martin, 2014 : 17-23) est une nécessité parce que la didactique souffre des pensées du discontinu, du fragmentaire, du saupoudrage, du manque d’orientation fondamentale, et des traditionnelles dichotomies que l’on a trop tendance à naturaliser alors que ce sont des constructions qui empêchent, dans les apprentissages/enseignements, toute articulation forte du savoir et du vivre : langue/lettres ; communication/expression ; oral/écrit ; populaire/savant ; contemporain/patrimoine… Il suffirait de rappeler les réflexions décisives d’un Humboldt, fondateur de l’Université de Berlin :
En disjoignant ainsi les éléments, on s’interdit précisément de reconnaître les valeurs les plus significatives, qui ne peuvent être perçues ou pressenties (ce qui prouve, s’il en était besoin, que la langue proprement dite réside dans l’acte qui la profère et l’effectue) ailleurs que dans les enchaînements du discours. (Humboldt : 183-184)
Plus décisivement, l’enjeu du dire est celui du corps-langage dont on sait combien il construit les identités-altérités concrètes et puissantes parce qu’« une rythmique du discours singulière […] rend indissociables la réalisation physique du discours et son organisation sémantique-rythmique » (Dessons, 1997). À la suite de Gilles Sioufi (2007), il est temps de rappeler que « le temps est venu des arts du langage » comme écoute et pratique vocales parce qu’une anthropologie et une linguistique de la parole ne peuvent que rendre à celle-ci ce que l’histoire spécifique du français en France a trop réprimé, séparé et reporté en accumulant les stigmatisations. Enfin, la transformation décisive et urgente de l’enseignement de la littérature en enseignement des œuvres à l’œuvre comme levier de multiples cultures langagières fortes d’oralité, constitue la condition sine qua non d’un enseignement efficace et ouvert du français dans et par un plurilinguisme bien compris : pluralité des paroles possibles des apprenants et des professeurs dans et par l’énonciation continuée des œuvres.
On comprend alors que ces essais de voix rendus possibles par une orientation décisive vers le dire dans les arts du langage et ouvrant à une oralité vive, demandent des transformations concrètes qui sont de l’ordre d’inflexions permettant de passer des applications aux interactions, des compétences aux voix, des progressions aux parcours, des maîtrises aux essais. Ces changements de paradigme ne constituent pas des impossibles mais une systématicité jamais envisagée jusqu’à aujourd’hui qui permettrait d’engager la didactique des littératures vers une gestualité du dire, de « minuscules improvisations », que Walter Benjamin apercevait dans l’expérience baudelairienne :
Baudelaire, poète, reproduit dans les feintes de sa prosodie les chocs et les coups que ses soucis lui donnaient, comme les cent trouvailles par lesquelles il les parait. Il faut, si l’on veut considérer sous le signe de l’escrime le travail que Baudelaire consacrait à ses poèmes, apprendre à les voir comme une succession ininterrompue de minuscules improvisations. (Benjamin, 2002 : 103)
Pour conclure, il resterait à poser quatre principes qui pourraient guider cette reprise de voix au cœur de l’enseignement, seul moyen de défaire les identitarismes comme les altruismes (Philippe Sollers osait le mot « autruisme » (2000 : 83 et Martin, 2002) qui n’est pas mauvais puisque souvent l’altruisme est une politique de l’autruche pour les identitarismes) qui toujours posent des essences sourdes aux expériences. Loin d’une conception applicationniste, l’articulation théorie-pratique d’une telle gestualité du dire n’est pas ante ni post mais au cœur des réénonciations comme processus de conceptualisation sous la forme d’essais où pratiques et théories s’associent, celles des élèves et des professeurs également. On ne peut concevoir une conceptualisation, didactique et/ou poétique, qui partirait de notions ou compétences arrêtées avant quelque essai de voix dans et par les œuvres continuées en réénonciations. Didactiques et théories de la littérature peuvent alors concevoir, dans la tension entre progressions assurées de leurs termes (notions comme repères) et points de voix, passages et reprises ouvrant à des relations, non seulement des échanges mais des racontages comme passages d’expériences-relations qui inventent des temporalités où les ressouvenirs en avant sont aussi importants que les projets – terme par trop pris dans le management. Enfin, si la didactique sans la poétique ne peut que se confiner dans la visée de la maîtrise et si la poétique sans la didactique pourrait réduire toute expérience à l’impossibilité de la maîtrise, on aimerait bien concevoir des reprises de lecture-écriture qui ouvrent à des essais de réénonciations où chacun fait œuvre avec les œuvres – personne d’autre ne pouvant faire à sa place ce travail d’historicisation qui engage la trans-subjectivation infinie qu’ouvre une œuvre, et par conséquent des sujets libres (s’)associant leurs voix y compris dans le désaccord des accords.
Bibliographie
AUERBACH, E. (2004). Le Haut Langage. Langage littéraire et public dans l’antiquité latine tardive et au Moyen Âge. Paris : Belin.
BENJAMIN, W. (2002). Le Paris du Second Empire chez Baudelaire. In C. Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme. Éd. R. Tiedemann, trad. et préf. J. Lacoste. Paris : Payot, « Petite bibliothèque Payot », p. 21-146.
BENVENISTE, É. (1966). Problèmes de linguistique générale, I. Paris : Gallimard, « Tel ».
BENVENISTE, É. (1974). Problèmes de linguistique générale, II. Paris : Gallimard, « Tel ».
BOUTET, J. & HELLER, M. (2007). « Enjeux sociaux de la sociolinguistique : pour une sociolinguistique critique ». Langage et société n°121-122, p. 305-318.
CERTEAU DE, M. (1980). L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris : Gallimard.
CHKLOVSKI, V. (2008). L’Art comme procédé, 1917. Paris : Allia.
CITTON, Y. (2007). Lire, interpréter, actualiser – Pourquoi les études littéraires ? Paris : Éditions Amsterdam.
DESSONS, G. (1997). La phrase comme phrasé. In La Licorne n°42 (« La phrase »), p. 41-53.
DEWEY, J. (2010). L’Art comme expérience (1934). Paris : Gallimard.
HUMBOLDT (VON), W. (1974). Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais. Paris : Seuil.
LATOUR, B. (2006). Changer de société. Refaire de la sociologie. Paris : La Découverte.
MARTIN, S. (2002). Écouter l’autre en écoutant le poème du langage. In D. Groux (dir), Pour une éducation à l’altérité. Paris : L’Harmattan, p. 73-84.
MARTIN, S. (2005). « Faire œuvre avec les œuvres », Le français aujourd’hui n°149, p. 67-73 ; en ligne à cette adresse : https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2005-2-page-67.htm
MARTIN, S. (2014). Poétique de la voix en littérature de jeunesse. Le racontage de la maternelle à l’université. Paris : L’Harmattan.
MARTIN, S. (2017). Voix et relation. Une poétique de l’art littéraire où tout se rattache, Taulignan, Marie Delarbre éditions.
MARTIN, S. (2018). « Je n’enseigne point, je raconte. La voix, la relation : réflexions théoriques et didactiques Avec Dany Laferrière et Gérard Noiret », revue Carnets n° 13. En ligne : https://journals.openedition.org/carnets/1926
MBEMBE, A. (2016). Politiques de l’inimitié. Paris : La Découverte.
MESCHONNIC, H. (1995). Politique du rythme, politique du sujet. Lagrasse : Verdier.
MESCHONNIC, H. (2003). Les Noms, traduction de l’Exode. Paris : Desclée de Brouwer.
PENNEQUIN, C. (2007). La ville est un trou. Paris : POL.
RICŒUR, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
SAUSSURE (DE), F. (1975). Éléments de linguistique générale. Paris : Payot.
SIOUFFI, G. (2007). « Du sentiment de la langue aux arts du langage ». Ela. Études de linguistique appliquée, n°147, p. 265-276.
SOLLERS, P. (2000). Passion fixe. Paris : Gallimard.
STAROBINSKI, J. (1968). La Relation critique. Paris : Gallimard.
TODOROV, T. (2015). L’Art ou la vie. Le cas Rembrandt suivi d’Art et morale. Paris : Seuil
[1] On peut ici se contenter de Boutet et Heller, 2007, pour apercevoir, selon elles, que le « socio » de la discipline dénommée « socio-linguistique » perd souvent sa force politique – toutefois la théorie du langage de la sociologie, y compris de la sociologie du langage, est trop souvent prise dans l’instrumentalisme représenté surtout par le performativisme du large courant pragmatique, et fait perdre l’articulation forte de l’anthropologique et du politique que Benveniste (1974 : 62) a tenue (voir Meschonnic, 1995).
[2] Voir les travaux de thèse de Carla Campos Cascales (« L’enseignement de la lecture littéraire : quel sujet lecteur pour quelle société ? », soutenue en 2020), de Frédérique Cosnier (« Passages des voix : quand les langues du poème créent l’inconnu du langage »), de Charlotte Guennoc (« Poétique de l’écoute : des expériences théâtrales en ateliers aux mouvements de la paroles dans les œuvres de Didier-Georges Gabily et Kateb Yacine »), et les deux thèses, soutenues en 2018, de Mathieu Depeursinge à Lausanne (« L’éducation poétique par l’illisible : enquête sur les conditions de la lecture en démocratie, dir. Antonio Rodriguez) et d’Olivier Mouginot à La Sorbonne nouvelle (« Les ateliers du dire (lectures, écritures, littératures). Enjeux et expériences de la voix en langue(s) étrangère(s) », dir. Serge Martin).